Blog
ENTRE DEUX IMAGES n°3
15 octobre 2014
NE SERAIT-CE QUE POUR RIRE / UMWELTFREUNDLICH : MENSCHEN-UNFREUNDLICH ? / UNE AUTRE JANET / GUERRE DU SIGNIFIANT 3 / VIVACITE / DIMENSIONS / LA BARRETTE ET LA PATTE DE LAPIN
McConaughey / Di Caprio / Scorsese / Hulot / Arthus-Bertrand / Gaynor / Murnau / Safaian / Hartmann / Macé / Priest / Pelléas / Kurosawa
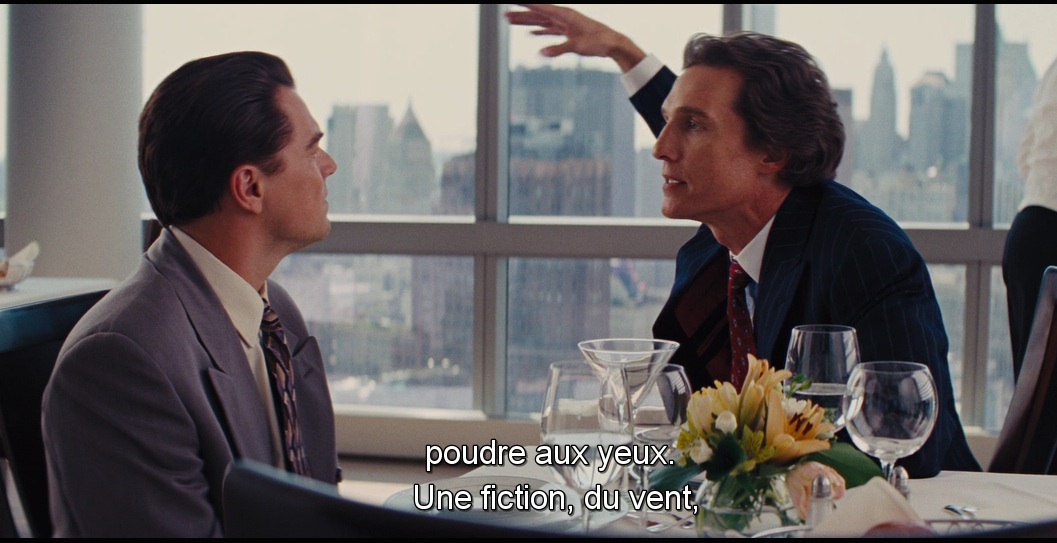
NE SERAIT-CE QUE POUR RIRE
Ne serait-ce que pour rire, j’adore revoir cette scène, vers le début du Loup de Wall Street, où Matthew McConaughey hypnotise littéralement le débutant courtier joué par Leonardo di Caprio, et le convertit en lui disant d’emblée la vérité : que ce métier consiste à vendre du vide et à escroquer des gogos en s’en mettant plein les poches. Son pendant est une autre grande scène avec le policier sur le bateau, lorsque ce dernier piège l’homme arrogant qu’est devenu Jordan Belfort. Je trouve d’ailleurs formidable l’ensemble du film : il n’est pas si facile de montrer, sans avoir l’air de se boucher le nez et en lui donnant son ampleur et sa grandeur réelle, la laideur du capitalisme boursier et son caractère immoral et avilissant, en même temps que séduisant. Ce style d’humour se trouve déjà dans un autre chef-d'oeuvre de Scorsese, The King of Comedy (La valse des pantins).
UMWELTFREUNDLICH : MENSCHENUNFREUNDLICH?
Il est vrai que ce film puise son énergie de pamphlet dans les excès mêmes qu’il épingle drôlement, et que la « cause du bien », les « bonnes causes », elles, ne sont pas si faciles à illustrer et à défendre avec des personnages exemplaires. Dans la doxa écologique, telle qu'elle se répète et parfois se serine à la radio (France Inter), dans la presse et même à la télévision, a fortiori dans les stupides documentaires de Nicolas Hulot et Yann Arthus-Bertrand, un certain nombre de choses me dérangent - et pourtant je suis, comme on dit en allemand, "umweltfreundlich", puisque je ne conduis pas, mange très peu de viande et trie le mieux que je peux mes déchets…
En vrac, 1) le plaisir d'humilier l'espèce humaine, de lui "mettre le nez dans son caca", or l'humiliation n'est jamais bonne ; 2) l'affectation de donner à tout le monde une égale responsabilité dans le phénomène des catastrophes écologiques - comme s'il n'y avait pas l’inégalité des classes, et donc des responsabilités ; 3) une façon monolithique de présenter les enjeux, de sorte que seul un pouvoir mondialisé - donc une dictature, comment en effet le constituer autrement - semblerait pouvoir inverser la situation... ; 4) un système de valeurs basé principalement sur la restriction et l’inhibition de tout enthousiasme.
UNE AUTRE JANET
Pourquoi suis-je devenu plus sensible à ce qui me semble éteindre la vie? Ainsi, j’aime un peu moins L'Aurore de Murnau (pourtant si beau), depuis que j'ai vu son actrice principale Janet Gaynor dans d'autres films, notamment dans L’Heure suprême de Borzage, ou dans une rareté intitulée Sunny Side Up (1929, réal. David Butler), une comédie musicale que l’on trouve sur Youtube et où elle est si piquante, effrontée, et dynamique… Alors que Murnau en fait une bonne petite Hausfrau, tellement éteinte et pleurarde qu’on est tenté de pardonner à George O’Brien d’avoir eu la tentation de la noyer. Le problème du film est que dans l’emploi de méchante, l’autre rôle féminin, celui de la « femme de la ville » joué par Margaret Livingston, est tout aussi peu convaincant. On trouve des personnages de femmes moins mièvres dans le Tartuffe, du même réalisateur.
LA GUERRE DU SIGNIFIANT 3
A trois semaines de distance, nous voyons à Berlin deux mises en scène d'opéra qui se répondent curieusement, bien que tout par ailleurs les oppose : une production modeste pour l'une (Exit Paradise, sur une musique d’Arash Safaian, au Neuköllner Oper) et tous les moyens d'un opéra d'état pour la seconde (le Simplicius Simplicissimus de Karl Amadeus Hartmann, écrit dans les années 30, au Schiller Theater) ; un sujet moderne pour la première (la vie d'un jeune couple fauché dans le Berlin actuel) et pour la première un sujet ancien (la Guerre de trente ans).
Le point commun, c'est l'idée "géniale" d'un décor métaphorique et unique qui n'est pas le décor réel de l'action: un manège de chevaux de bois pour Exit Paradise (alors que l'action se déroule dans des rues populaires et des appartements modestes), une bibliothèque poussiéreuse pour l'opéra de Hartmann (alors que les lieux de l’action sont une cour de ferme, la campagne, etc..). Chaque décor unique symbolise quelque chose. Pour le premier opéra, le fait que les personnages vivent un rêve enfantin au-dessus de leur condition, pour le second, l’idée que la meurtrière Guerre de Trente ans ne serait plus qu'un événement ancien attendant qu'un érudit, un savant ne le tire de la poussière des bibliothèques pour le faire peu à peu s'incarner…. Malheureusement, nous ne sommes pas au cinéma. Cela veut dire qu'une fois que vous avez mis en place votre décor symbolique, vous ne pouvez pas l'escamoter et passer à autre chose. Alors, comme ce sacré manège de foire et cette satanée bibliothèque (énorme, je n'ai pas compté, mais il y doit y avoir trois milles livres reliés sur de grandes hauteurs de rayonnage), sont là, la mise en scène s’escrime à les exploiter, à leur faire signifier ce qu'ils ne sont pas : une maison, un champ de bataille, la vie, la mort, tout ce qu’on veut ; les livres représentent des vies humaines, puis des livres, puis on ne sait plus quoi. Le Décor Unique Métaphorique, s'il faut baptiser cet effet devenu un cliché, s'érige en héros, en tyran de la représentation, il s'agit de l'exploiter, de le rentabiliser, de le pressurer, quitte à créer mille associations de sens parasitant l'histoire (par exemple, dans Simplicius, un des coins de la bibliothèque pivote et cache une porte secrète, ce qui renvoie plus à Arsène Lupin qu’à la Guerre de Trente Ans).
Bref, le D.U.M., pour ériger en sigle ce type de parti-pris, devient un signifiant écrasant : on veut prouver qu'on le "maîtrise", qu'on en fait ce qu'on veut, qu'on lui fait représenter tout et son contraire, alors qu'on en devient l'esclave.
Je semble dire qu’il faudrait que le théâtre revienne au principe du décor littéral et conforme à l’action. C'est parfois une bonne solution, mais il y en a une autre, qui est de n'en avoir aucun. J’ai vu enfant, dans les années 50-60, plusieurs mises en scène de Musset, de Brecht, Kleist, Calderon, au TNP de Chaillot, sans décor sinon parfois une chaise… On comprenait ce qui se passait et où on était par les mots, l’action, quelques effets sonores, la lumière. Les acteurs (ou chanteurs) ne perdaient pas leur énergie à justifier la présence d'un audacieux décor "décalé".
VIVACITE
A Paris, dans un concert du GRM, une création attachante de Pierre-Yves Macé pour sons fixés : Phonotopies 1. Certains, que j’ai du mal à comprendre, lui reprochent de faire entendre... des instruments enregistrés. Or, justement, avec cette musique concrète de Macé, l’imbrication de phrases musicales enregistrées jouées sur des instruments à vent dans des lieux de plein air, avec ce qu’apportent ces lieux mêmes, crée plus que ce que l’on appelle platement un " dialogue". Grâce à un usage extrêmement vivant du montage, et au refus même de traiter ces sons, sinon par coupes et mélanges, advient ce que j'appelle une dialectique médiatiste entre ce qui est fixé et le support de fixation, il y a des basculements, des renversements, toute une vivacité nouvelle qui se manifeste.
DIMENSIONS
Lorsque je dois passer quelques jours dans un hôtel ou une résidence en pays étranger, il me faut, les premiers soirs, faire une promenade à pied dans les proches environs, en tissant ma toile dans différentes directions, comme si je devais “scanner” l’endroit où je suis pour m’en faire une représentation en relief, et comme si, d’avoir vu mon hôtel ou mon immeuble en façade, dans sa rue, ne m’en donnait qu’une carte postale dont je n’étais pas sûr qu’elle ne fût pas plate et trompeuse. Cela m’amène toujours à découvrir un but de promenade que je n’avais pas remarqué sur le plan du quartier, et qui pourra devenir le point où me ramènent mes brèves pérégrinations, avant de regagner mon logement. A un moment donné, une fois essayées diverses rues, l’espace est comme saturé, je retombe logiquement sur les mêmes rues, les mêmes façades ; j’ai vérifié que l’espace se connecte bien, qu’il n’y a que trois dimensions (deux pour un piéton) et qu’inévitablement, tel un ruban de Moebius à quatre/trois dimensions, l’espace se boucle sur lui-même, grâce au temps.
La belle affaire, cependant que de dire que le temps est une quatrième dimension. Ce n’est pas cela du tout. Parce que même quand j’ai retrouvé la boucle, quelque chose de l’espace s’est déplacé. J’en reviens à ce roman prodigieux de l’anglais Christopher Priest Inverted World, publié en 1974 (Le Monde inverti, en traduction française), que j’ai lu deux fois dans deux circonstances cruciales de ma vie, et où l’auteur est parvenu à donner une forme romanesque à cette question de la relation temps/espace, au sens existentiel. Priest est un des grands auteurs vivants, je viens de découvrir qu’il tient un blog sur son Website.
LA BARRETTE ET LA PATTE DE LAPIN
Pour finir, une histoire qui se déroule en une journée. Par un matin d'octobre, notre personnage sort d'une consultation médicale qu'il appréhendait beaucoup, mais qu'il a eu le courage de demander : il s'agissait de faire examiner telle anomalie, pour vérifier si elle n'était pas le signe débutant d'une tumeur maligne, bref d'un cancer. Le spécialiste le rassure pleinement, et l'homme dont je raconte l'histoire est convaincu et délivré. Mais comme sa nature anxieuse a horreur du vide, le voilà, puisqu'il doit prendre l'avion, à s'inquiéter de ce qui, en comparaison de ce qu'il craignait une heure avant, est une broutille : le risque de ne pas arriver à temps à l'aéroport. Il y arrive ! Mais il n'a qu'un bagage à main, pour lequel il craint d'avoir à payer une surtaxe si ce bagage était jugé trop lourd. Anxiété du héros. Le bagage passe sans problème, etc... Enfin, l'avion va décoller à l'heure, et notre personnage attend ce moment qui le fait toujours penser à un crash possible, mais où il va se sentir enfin déresponsabilisé : ce moment où, comme dit un personnage de Pelléas et Mélisande : "Tout est perdu. Tout est sauvé. Ce n'est plus nous qui le voulons."
A bord, au moment où l'avion va quitter le sol, sa voisine de gauche - une Russe apparemment, à l'entendre parler - fait à toute allure (peut-être par crainte de paraître ridicule) un triple signe de croix, puis elle serre fermement de sa main gauche, durant une bonne partie du trajet, un objet allongé en fourrure blanche qui semble bien être une patte de lapin porte-bonheur, tout en continuant de tapoter de l'autre main son smartphone. Une heure trente plus tard, l'avion atterrit à l'heure et sans incidents, et la femme donne une autre fonction à sa patte de lapin : celle d'une barrette en fourrure, assez voyante, avec laquelle elle tient ses cheveux blonds en queue de cheval. Car j'ai oublié de dire qu'elle avait de longs cheveux libres.
Que penser de cette histoire ? Le personnage de la femme est visuel, tandis que celui de l'homme est non seulement assommant, mais aussi peu propice à un film (il faudrait passer par le truchement fastidieux au cinéma de la "voix intérieure").
Autrement plus touchant que notre hypocondriaque est ce personnage, dans un film de Kurosawa (Scandale, 1950), d'une petite malade confinée à domicile : elle s'occupe et participe à la vie en regardant le jardinet visible de sa couche.
