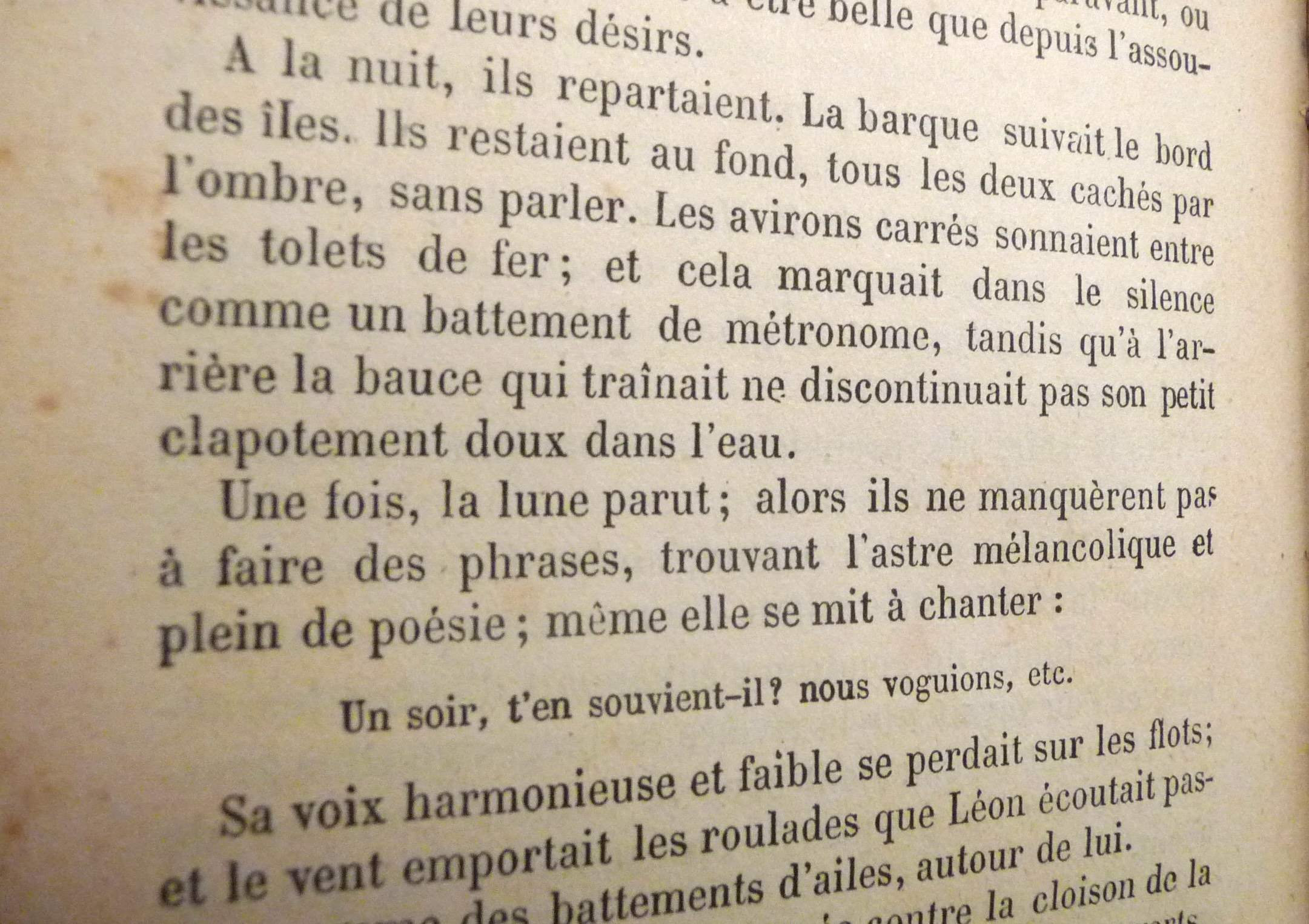Blog
SANS VISIBILITÉ - CHAPITRE 14
28 février 2021
DE BROSSE À PROSE, DE PROSE À VERS ET À OPÉRA : LA FIN DU PARLÉ ?
Marguin / Montel / Morinaga / Harwood / Tazartès / Vertov / Molière / Dante / Flaubert / Ravel / Meschonnic / Gribenski / Kafka / Cadiot / Berlioz / Wagner / Desnos / Poe

Lorsque Franck Marguin, Geoffroy Montel et moi avons cherché une image destinée à illustrer la pochette de l’édition en 2 CD par Brocoli de mon œuvre La vie en prose, une symphonie concrète, elle n'a pas été évidente à trouver. La pièce, terminée en 2010, dure une heure vingt, mais il ne fallait pas quelque chose de pompeux, car La vie en prose alterne l’intime et le collectif, l’intérieur (dans les mouvements 1 et 3) et le plein air dans (mouvements 2 et 4). J'aime me rappeler que cette composition a été créée en quatre fois dans quatre villes, le premier mouvement en 2006 à Paris au GRM, le deuxième en 2009 à Montréal, où Réseaux m’avait invité, les troisième et quatrième la même année à Yokohama, grâce à Yasuhiro Morinaga, et enfin la totalité - qui depuis n’a jamais été redonnée en concert - à Londres au Café Oto, en 2010, lorsque Mark Harwood nous avait réunis Ghédalia Tazartès (voir blog n°12 de Sans visibilité) et moi. Cette création en pièces détachées est tout à fait conforme à mon idée de diviser cette œuvre en grands morceaux à la fois solidaires et indépendants : Le chant des heures, Le souffle court, Dans la chambre, Salut au jour. Mais aujourd'hui, cette symphonie, même si cela limite les possibilités de sa diffusion en concert, est insécable.
Finalement, c’est dans le célèbre film de montage de Dziga Vertov, L’Homme à la caméra, que j'ai trouvé l’image, ou plutôt les quatre images qui me convenaient pour la pochette : quatre phases d’un brossage de dents particulièrement énergique, d’une jeune dame en gros plan. Je retrouvais là ce mélange de quotidienneté et de dynamisme qui était l'esprit que j'avais voulu donner à ma musique. Ce n’est que récemment que j’ai trouvé le rapport entre la brosse à dent et La vie en prose, aidé en cela par un critique anglais qui avait pris la peine de repérer dans l’œuvre la seule et unique évocation sonore d’un brossage de dents lors de ses 80 minutes. Brosse et prose sont deux mots français qui présentent une curieuse symétrie : dans brosse le b est une consonne dite voisée et le double s une consonne dite non voisée. Prose intervertit les places, puisque p est la variante non voisée de b, et le s se prononce comme la variante voisée de s. Structure binaire par couples d’oppositions, sur laquelle repose la phonologie de beaucoup de langues. De même, et surtout grâce à Molière et à son Monsieur Jourdain qui, dans Le Bourgeois gentilhomme, s’émerveille de parler en prose sans le savoir parce qu’il ne parle pas en vers rimés, prose et vers sont aussi un couple très fort et qui n’est pas si facile à dépasser. Même si la poésie française du XXème siècle a très souvent abandonné ce qui spécifiait qu’on avait affaire à de la poésie, à savoir les mètres réguliers et le jeu des rimes alternativement féminines et masculines, la rime revient et insiste aujourd'hui dans la chanson populaire, le rap et le slam.
Comme la prose française ne se définit que négativement, par la rime en tant qu'absente et par la non-périodicité métrique, j'avais choisi d'écrire, ironiquement, pour la création à la Maison de la Radio, en 2006, du premier mouvement de La Vie en prose (qui ne s’appelait pas encore Le chant des heures mais L’horrible tissu des jours), un quatrain rimé en octosyllabes :
Qu’elle soit en noir ou en rose,
Vie de château ou vie de chien,
Je vous dirai la vie en prose,
Car elle ne rime avec rien.
Ce qui ne rime avec rien – au sens figuré de « rimer avec », non au sens propre - c'est ici la vie elle-même. Mais l'expression signifie bien que la rime, ou son absence, n'est pas une question-joujou. Que serait le sublime édifice de la Divine comédie de Dante sans le procédé de la rime tierce, la terza rima, qui tout en faisant venir des idées et des comparaisons pour les nécessités de rimer, tresse étroitement le texte et chante l'unité divine, mettant partout -même dans l'Inferno ! – l'amour, cet amour qui « meut le soleil et les autres étoiles. »
Cela faisait longtemps que je tournais autour de l'idée d'une musique en prose, c’est-à-dire à la fois délivrée d’une sorte de lourdeur attachée à l’emploi d’instruments nobles, et par ailleurs s’ouvrant, comme la peinture et la littérature l'ont fait depuis longtemps, au tout-venant de la vie, même si cette vie, chez moi, est principalement recréée en studio. Une œuvre bien antérieure comme La Ronde, 1982,en relève déjà.
Lorsque j’entends une œuvre contemporaine de concert avec un violoncelle qui violoncellise, un piano plus pianistique qu'il n'est permis, ou une flûte traversière à clefs qui singe tant bien que mal le shakuhachi japonais, j’ai parfois l’impression d’entendre musicalement l’équivalent d’une poésie désuète dans laquelle au lieu d’eau on dit onde, au lieu de cheval coursier, et au lieu de bronze airain. En d’autres termes, les instruments classiques représentent à mes oreilles, en tout cas pour certaines esthétiques qui entendent sortir du système tonal/modal, un vocabulaire passé et convenu, maintenu par le rite social et culturel. La musique concrète me permet de créer un vocabulaire musical spécifique à chaque œuvre, vocabulaire qui n’est pas spécialement bruitiste ou prosaïque dans le sens péjoratif du mot, mais qui est délivré du poids culturel de tous les instruments de l’orchestre occidental, tout en pouvant incorporer le son de ceux-ci comme « son fixé », dans une cohabitation démocratique avec tous les autres sons. Dans ma brève Suite volatile de 1984, on entend quatre instruments dont je joue tous les quatre, un piano préparé, une flûte à bec alto, une cithare et un clavicorde préparé, mais c'est dans un style faussement spontané. Les instruments ne semblent pas posés mais se déplacent dans un espace commun où ils cohabitent avec des glouglous, des chants d'oiseaux, des ronflements de dormeur, ma voix affligée d'une laryngite (authentique), etc.
J’avais été frappé par une remarque de Flaubert dans sa Correspondance, disant que les combinaisons de la poésie en vers lui paraissaient épuisées et que le temps était venu d’une prose cadencée (ci-dessous, une scène de Madame Bovary). Les compositeurs eux-mêmes, un peu plus tard, dont Ravel, s’intéressèrent à cette question pour la musique, mais les traditions de la partition écrite et de l'instrumentarium traditionnel les ont freinés dans cette voie. Mais la question de la prose – notion qui ne se définit que négativement, comme ce qui n'est pas en vers, de même que le parlé n'est en fait qu'un pêle-mêle où se retrouverait tout ce qui n'est pas chanté - continue de m'intéresser comme compositeur. Ces questions ne sont pas poussiéreuses, elles concernent la théorie du langage qui est aussi, disait Henri Meschonnic, la théorie de l’histoire.
C’est pourquoi, lorsque Michel Gribenski, un ami dont nous avions fait la connaissance au Wiko à Berlin, m’a fait cadeau de la belle édition, admirablement mise en page et imprimée au service de la plus grande lisibilité, de son essai foisonnant Le chant de la prose, Généalogie de l’opéra en prose française (1659-1902), je m'y suis plongé avec gourmandise. C'est un régal, une sorte de conte de fée littéraire, aussi bien pour tous les documents d'époque le plus souvent inconnus ou négligés que Gribenski a su rassembler sur ce thème, que pour la problématique très pointue et vivace qu’il développe à leur propos. On sent que c’est pour lui une question vivante et d’ailleurs pour moi elle continue d’être sensible dans les nombreux opéras créés en France au cours de ces trente dernières années. Face à ces opéras, je me suis souvent dit que le compositeur n'avait pas problématisé la question du chant et du texte, et même qu'il n’avait pas de rapport fort à son livret : qu'il s'agît d'un livret adapté du Procès de Kafka et chanté en allemand, ou bien d'un texte « littéraire » d’Olivier Cadiot, les auteurs semblaient considérer qu’il suffisait de superposer un texte d'écrivain et une musique musicale, et que cela s’additionnerait tout seul. Ce n'est pas si simple. Dans son Chant de la prose, (titre volontairement oxymorique), Michel Gribenski démontre admirablement comment les recherches de Wagner, qui avait décidé d'être son propre librettiste pour sortir de la platitude des livrets habituels, et qui travaillait beaucoup sur les allitérations, ont paradoxalement préparé le terrain de l’opéra en prose français dont Pelléas et Mélisande est l’exemple le plus connu, mais il y en a eu d’autres.
Ce que j'aime aussi, c'est que l'auteur ne se perd pas dans le dédale de ses trouvailles érudites. Il a ses idées et sait aussi rendre à Molière ce qui revient à Molière, à savoir – c'est moi qui le comprends ainsi – d'avoir été un grand penseur en acte de la langue française, en vers réguliers (ou irréguliers) comme en prose, pour la récitation comme pour le chant. Ses charges contre la langue des Précieuses en sont un des aspects parmi d'autres.
Pour ma part, pour qualifier mes œuvres dramatiques en musique concrète j’ai souvent hésité entre les termes d'opéra et de mélodrame - qui veut dire drame déclamé accompagné de musique, mot que j’aime beaucoup mais qui est souvent compris péjorativement. En tout cas, j’ai imité Berlioz et Wagner en étant assez souvent mon propre librettiste, et lorsque je puise chez Desnos, Flaubert ou Edgar Poe, c'est en restructurant complètement ces textes, généralement en prose. Des textes que je veux que l'on comprenne, c'est pourquoi chacune de mes œuvres est désormais disponible en version sous-titrée.
Mes livrets sont rarement chantés (pourquoi le seraient-ils ? Nous sommes dans le monde de la musique des sons fixés, et le chant n'est pas le critère sine qua non de la musique quand il y a un texte), mais ils ne sont pas pour autant « parlés » . Ils sont plutôt récités, hurlés, chuchotés, minaudés, glapis, bégayés, exclamés, crachés, déclamés, expirés, soupirés, grommelés, rugis, marmonnés, gémis, susurrés, psalmodiés, éructés, insinués, vomis ou grincés, ou simplement lus. Et parfois ponctuellement chantonnés (Gloria), ou vocalisés en style atonal (Diktat). Mais l'abandon de l'obligation du chanté me permet d'ouvrir et de diversifier tout ce qui est dit en une variété de formes qui échappent à la trop facile catégorisation comme « parlé » ; autrement dit, la présence envahissante du chanté cesse de parquer en une catégorie-ghetto tout ce qui n'est pas lui (il faudrait voir ce qu'il en est avec le « scandé » et le « déclamé » propres à ces domaines que je connais mal, le rap et le slam).
Vous ne voyez pas clairement le fil continu entre toutes ces questions ? Rassurez-vous, moi non plus, j'avance en tâtonnant, aussi bien en composant qu'en écrivant. Tout cela n'est pas simple, cela passe par un processus historique, celui que l'essai novateur Le chant de la prose est sans doute le premier à aborder d'une façon aussi ample à propos de l'opéra.